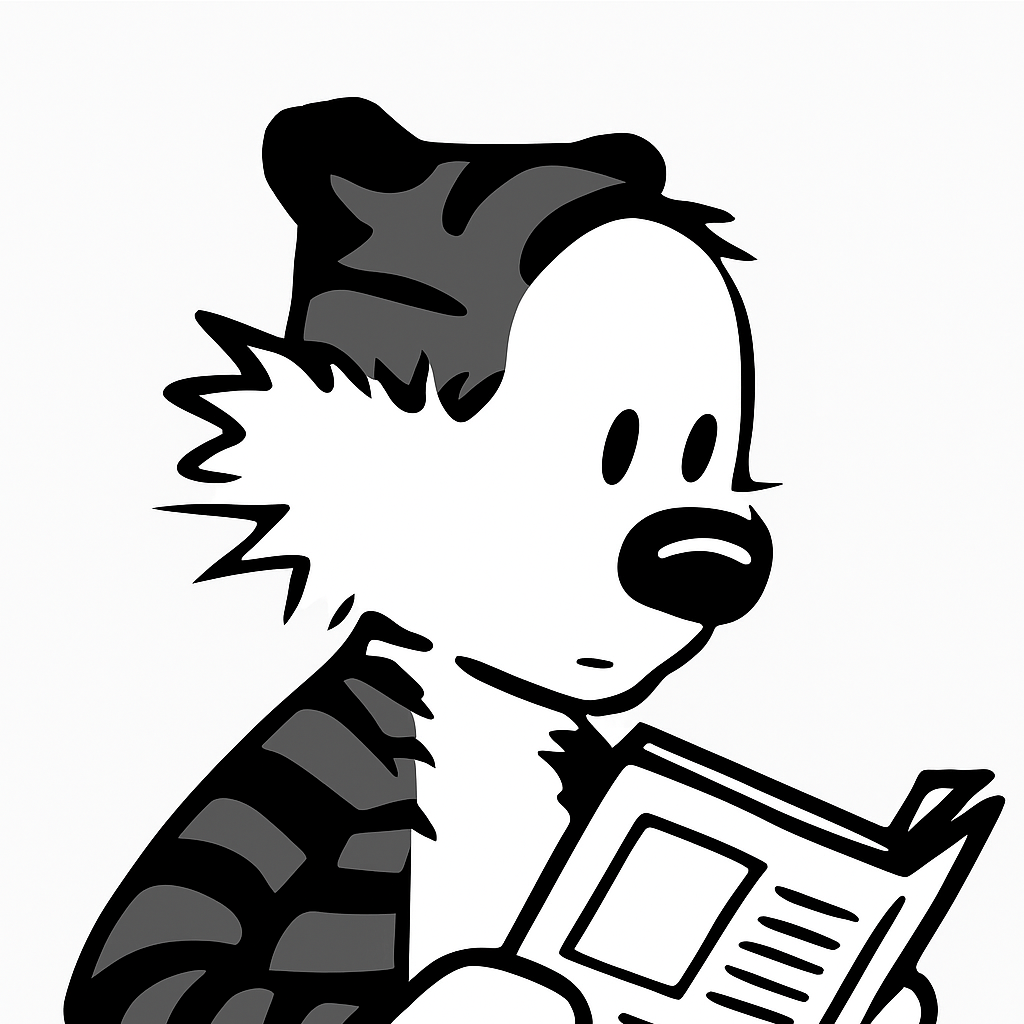Nicolas Lerner, qui dirige le renseignement intérieur, évoque le suivi des détenus radicalisés après leur sortie de prison, les mutations du phénomène djihadiste et l’impact du conflit au Proche-Orient sur la menace en France.
Comme l’auteur de l’attentat d’Arras, dans le Pas-de-Calais, celui de l’attaque au couteau, à Paris, était suivi par la DGSI. Est-ce un échec pour votre service ?
Il n’y a pas une journée qui passe sans que les quelque 5 000 agents de la DGSI ne soient mobilisés : 73 attentats ont été déjoués depuis 2013, 43 depuis 2017. Rien que depuis mars 2023, trois ont pu être empêchés par la DGSI.
Depuis l’assassinat de Samuel Paty, conformément aux instructions de fermeté du ministre de l’intérieur [Gérald Darmanin], 545 étrangers inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ont par ailleurs été éloignés. Au regard de cet investissement quotidien, chaque passage à l’acte constitue pour nous une amère frustration et une immense tristesse.
Ces deux attaques marquent-elles un retour de la menace terroriste en France après une période d’accalmie ?
L’attaque d’Arras intervenait, en effet, après une période d’un an et demi sans attentat. Le dernier traité comme tel judiciairement, c’était l’assassinat d’Yvan Colonna en détention, en mars 2022. Mais si on considère uniquement les attentats survenus hors détention, il fallait remonter à l’assassinat de Stéphanie Monfermé, à Rambouillet (Yvelines), en avril 2021, il y a deux ans et demi.
De fait, nous constatons depuis plus d’un an que cette menace est de nouveau orientée à la hausse sous l’effet de trois facteurs. D’abord, une redynamisation de la mouvance endogène, singulièrement portée par de très jeunes individus. Deuxièmement, l’ancrage persistant dans l’idéologie djihadiste de profils expérimentés et animés d’une volonté intacte de nous frapper. Et, troisièmement, le retour de la menace en lien avec des théâtres extérieurs.
Les Français doivent-ils apprendre à vivre avec cette menace et accepter que le risque zéro n’existe pas ?
Aucun pays au monde, même parmi les plus autoritaires, ne peut prétendre être aujourd’hui à l’abri du risque terroriste. Il est très important de prendre conscience du fait que l’idéologie islamiste existera sans doute encore très longtemps. Les Français doivent savoir que cette menace va persister et que ce combat acharné s’inscrira nécessairement dans la durée.
L’attentat du samedi 2 décembre, à Paris, soulève la question du suivi des détenus radicalisés à leur sortie de prison. Comment s’organise leur prise en charge ?
La DGSI estime que parmi les 391 détenus aujourd’hui incarcérés pour des faits de terrorisme, un « noyau dur » d’une cinquantaine d’individus présentent, à ce stade de leur peine qui est encore longue, un profil particulièrement inquiétant.
En outre, depuis l’été 2018, 486 détenus islamistes ont été libérés. Ce nombre peut sembler élevé, mais fort heureusement, tous les sortants ne présentent pas le même niveau de dangerosité. Le taux de récidive est d’ailleurs très faible.
En effet, contrairement à ce que j’entends parfois, un nombre significatif d’entre eux a pris du recul par rapport à leurs engagements précédents grâce notamment aux efforts de l’administration pénitentiaire et aux suivis judiciaires mis en place à leur sortie. Même s’il faut rester vigilant, plus de la moitié de ces sortants présentent aujourd’hui un profil que nous considérons comme « désengagé ».
Parmi l’autre moitié, aux profils plus ambivalents, certains restent ancrés dans l’idéologie radicale. Chaque sortant, quel que soit son profil, fait donc l’objet d’un suivi systématique par un service de renseignement, et la quasi-totalité se voit appliquer des mesures judiciaires et/ou administratives visant à favoriser la réinsertion et à leur imposer un dispositif de contrôle renforcé.
La DGSI déploie par ailleurs des dispositifs de surveillance humaine et technique importants avec l’objectif de caractériser tout comportement susceptible d’entraîner une entrave judiciaire. Depuis septembre, cinq sortants ont ainsi été réincarcérés pour des violations de leurs mesures administratives. Deux autres, sortis de prison très récemment, ont été interpellés en octobre : ils ont été condamnés à cinq ans et six ans de prison pour apologie du terrorisme.
L’enjeu, c’est d’arriver à détecter ceux qui sont susceptibles de nouveau de passer à l’acte. Les services, évidemment, surveillent. Mais malgré leur investissement, ils restent à la merci d’un passage à l’acte soudain, soit au terme d’un comportement dissimulateur, soit du fait d’une décompensation, sans qu’il y ait forcément de signes avant-coureurs.
Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a parlé, concernant le suivi de l’auteur de l’attentat de Paris, d’un « ratage psychiatrique ». Quelle difficulté pose la prise en compte des individus présentant des troubles psychiques ?
Parmi les 5 200 objectifs inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et suivis par la DGSI, 20 % présentent un trouble psychique documenté. Et sur les douze attentats que la France a connus depuis fin 2018, sept auteurs présentaient des troubles soit psychiatriques, dans un nombre restreint de cas, soit psychologiques. On ne peut pas faire comme si cette réalité n’existait pas.
Un attentat est toujours le résultat de deux composantes : une idéologie mortifère et un auteur qui, pour des raisons complexes et personnelles, se montre réceptif à cette propagande. Prévenir une dérive violente lorsqu’il existe un trouble de la santé mentale, c’est donc à la fois, bien sûr, le travail des services de renseignement, mais ça doit aussi être celui des professionnels de santé qui peuvent contribuer à limiter les risques de passage à l’acte.
Ce type d’individus peut en effet alterner des phases d’apaisement et d’agitation qui rendent le suivi policier particulièrement complexe. Ils peuvent se montrer très sensibles à une influence extérieure, à un événement de leur vie ou à un élément d’actualité. Nous ne sommes ni psychiatres ni psychologues, et il est parfois difficile pour nous d’apprécier leurs comportements.
C’est la raison pour laquelle la DGSI a décidé, il y a deux ans, de structurer un dialogue respectueux avec les représentants de la profession et d’intégrer en son sein deux psychiatres qui nous aident à procéder à des examens de situation. Les préfets ont aussi été invités à s’attacher les services d’un médecin pour faire en sorte que ceux qui en ont besoin puissent accéder à des soins.
Gérald Darmanin a justement proposé que les préfets puissent ordonner des « injonctions administratives » de soins…
C’est un des enjeux identifiés : comment faire en sorte qu’un individu qui semble devoir bénéficier a minima d’un diagnostic médical puisse voir un médecin ? Le droit prévoit un dispositif d’hospitalisation sous contrainte, mais qui demande soit l’intervention d’un tiers proche, soit celle du préfet ou du maire, et qui est alors conditionné à un trouble objectif à l’ordre public.
La difficulté survient quand on pressent une fragilité psychique qui ne se caractérise pas par un état de crise, comme c’était le cas pour l’auteur de l’attentat de samedi. La proposition portée par le ministre vise à mettre en place un système qui permette d’obliger ces personnes à se soumettre à un examen médical, à charge ensuite aux médecins de poser un diagnostic. Sur le plan opérationnel, ce serait une vraie plus-value pour les services de renseignement.
L’auteur de l’attentat de samedi a évoqué la situation au Proche-Orient dans sa revendication. Comment analysez-vous l’impact de ce conflit ?
Indéniablement, ce conflit a des conséquences directes sur la menace en France. D’abord parce que les grandes organisations terroristes, Al-Qaida et l’Etat islamique [EI], ont appelé à travers plusieurs dizaines de communiqués à une réaction de solidarité à l’égard des « frères palestiniens ». Dans le cas de l’EI, qui a une aversion pour les causes nationalistes comme celle du Hamas, si la réaction a pris plus de temps et revêt un caractère opportuniste, elle n’en produit pas moins ses effets.
Dans le même temps fleurit une série de discours irresponsables qui tendent à présenter la France comme la « complice inconditionnelle » de l’Etat d’Israël dans son « entreprise de génocide du peuple palestinien ». Ces discours ont pour conséquence, de manière évidemment plus insidieuse, de désigner la France comme une cible légitime pour toutes celles et tous ceux qui ont une lecture essentialiste ou religieuse de ce conflit.
Incluez-vous parmi ces discours des prises de parole politiques ?
J’inclus des prises de paroles de toute nature.
Quelles sont les grandes tendances de l’évolution de la menace terroriste en lien avec des théâtres extérieurs ?
Trois zones retiennent notre attention. D’abord la zone sahélienne et africaine. A court terme, les organisations terroristes qui y sont présentes sont engagées dans un agenda local. Mais si ces groupes devaient de nouveau conquérir des emprises territoriales, cela pourrait accroître leur attractivité et donner lieu à la création de filières qui, pour l’heure, n’existent pas.
Vient ensuite le théâtre syro-irakien, où l’EI conserve une résilience préoccupante et, enfin, le théâtre afghan, où le nombre de combattants de l’EI a presque décuplé depuis deux années. Le phénomène auquel on assiste depuis un an est moins un risque de projection de la menace – au sens où on l’entendait en 2015 avec des opérationnels qui quitteraient la zone pour venir nous frapper – qu’une activation à distance de sympathisants depuis une zone de djihad.
Trois exemples récents illustrent cette nouvelle forme de menace : le premier a été entravé par la DGSI en novembre 2022 à Strasbourg, avec l’interpellation d’un ressortissant tadjik et d’un Tchétchène dont tout laisse à penser qu’ils ont été activés par des opérationnels de l’EI en Afghanistan pour frapper la France, ce qui serait une première. Pendant l’été, des partenaires européens ont également interpellé des individus présentant le même profil. Enfin, la police suédoise a arrêté des individus en lien direct avec l’EI en Syrie.
Vous l’évoquiez plus haut, plusieurs projets d’attentats récents ont frappé les esprits par le jeune âge de leurs auteurs. Comment expliquer cette tendance ?
Les trois projets d’attentat déjoués par la DGSI en 2023 impliquaient des individus qui avaient tous moins de 20 ans. Le plus jeune avait 13 ans. Deux autres avaient 14 ans. Dans plusieurs de ces affaires – parfois traitées avec nos partenaires européens, parce que ce phénomène n’est pas que français, il est européen –, ces jeunes velléitaires ne fréquentaient pas de mosquées ni des lieux de socialisation : ils se structuraient en ligne, sur les réseaux sociaux, à travers un enfermement idéologique et numérique très préoccupant.
Notre analyse, c’est que l’attrait pour l’idéologie djihadiste a significativement diminué du fait de la déroute de l’EI dans les années 2017-2018, notamment auprès des générations qui s’étaient engagées au début des années 2010. Mais la propagande de l’EI revient aujourd’hui séduire une nouvelle génération d’adolescents qui, pour des raisons diverses – une quête identitaire, l’écho d’un discours de victimisation, une glorification de pulsions violentes qu’ils peuvent nourrir par ailleurs – se montre de nouveau sensible à cette idéologie mortifère.
Signe de cette tendance : pendant quasiment trois ans, aucun auteur d’attentats commis en France ne s’était revendiqué de l’EI. Or, lors des trois dernières attaques perpétrées en Europe, que ce soit à Bruxelles, Arras ou Paris, l’auteur s’est revendiqué de ce groupe. L’idéologie djihadiste n’est pas morte, et l’EI bénéficie d’un attrait nouveau au sein de ces jeunes générations.