

De mémoire il y a des pétitions comme celle-ci chaque année, est-ce que 14000 c’est particulièrement plus que d’habitude ? à quand la petite visualisation de l’évolution dans le temps :)


De mémoire il y a des pétitions comme celle-ci chaque année, est-ce que 14000 c’est particulièrement plus que d’habitude ? à quand la petite visualisation de l’évolution dans le temps :)


Same as what the others said: in France, non-French EU citizens can vote for EU parliament and municipal elections (electing a mayor). However, you need French citizenship in order to vote for your parliamentary representative (which could be misunderstood as “local” as it is on a district level), and for presidential elections.
I’m actually curious to know why local elections specifically, if it’s an EU directive or just “common” ?


c’est du role play de président ? je n’y comprends rien


Si le site dédié c’est Europresse, alors il existe l’extension Ophirofox sur Firefox/Chrome qui simplifie beaucoup le processus (un bouton apparaît directement sur le site de presse et on a presque l’article en un clic). Et la bonne nouvelle, c’est que ça marche du tonnerre avec Firefox mobile (cf le nouveau bouton “Lire sur Europresse”):
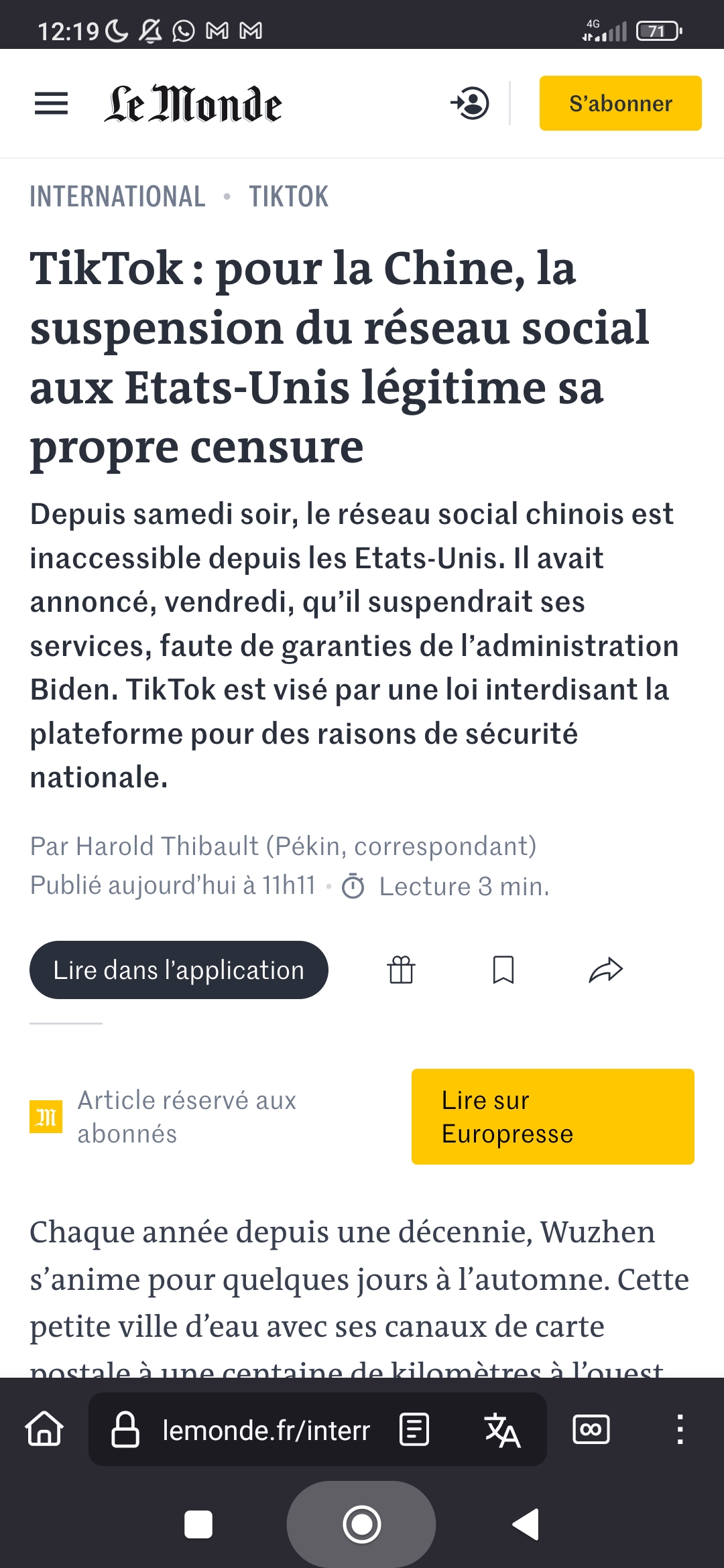
Tout est sur https://ophirofox.ophir.dev/, notamment l’installation sur mobile.

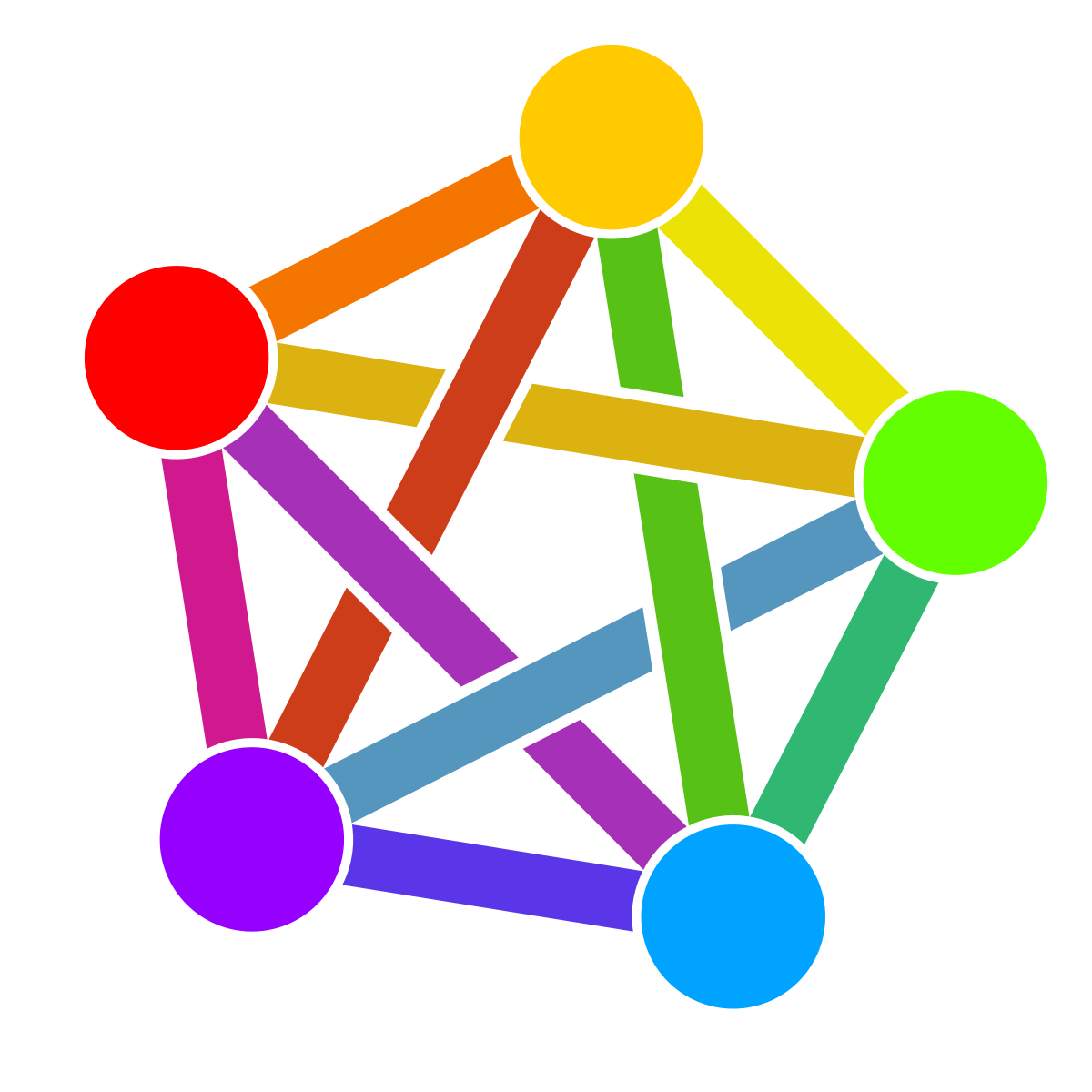
Hm, they have control over the instance but not directly (except if they fork etc) over the software? So comparing to reddit they can’t modify the UI to include ads, can’t inject tracking, etc.


Le RN réhabilite Jean-Marie Le Pen sans faire de vagues
Clément Guillou
Les dirigeants du RN, qui craignaient une possible « rediabolisation » du parti à la mort de son fondateur, ont salué son parcours sans nuance, encouragés par un discours médiatique et politique très mesuré.
Il l’avait anticipée, visualisée, commentée depuis des années. Jean-Marie Le Pen n’avait rien à craindre de sa propre mort, survenue le 7 janvier. Ses successeurs davantage. Ils ignoraient sincèrement quelle en serait la réception par les Français, la presse, la classe politique, et les possibles retombées politiques. Les chausse-trappes étaient innombrables. Elles semblent, pour le Rassemblement national (RN), avoir été évitées. A bien des égards, la séquence offre une perspective paradoxale : la famille Le Pen a pu gagner en humanité, longtemps son point faible dans les enquêtes d’opinion, au moment même où elle saluait l’œuvre de son représentant le plus détesté et communiait avec les franges radicales de l’extrême droite.
Le mouvement de Marine Le Pen pouvait craindre la division dans ses rangs, entre les cadres et députés ayant adhéré par fascination pour Jean-Marie Le Pen et ceux qui ne l’ont rejoint qu’après son exclusion du parti par sa fille. Comme en octobre 2023, lorsqu’une députée RN avait qualifié le cofondateur d’antisémite, après que Jordan Bardella avait dit l’inverse. Cette fois, le respect dû aux morts a autorisé tous les élus, quelle que soit leur sensibilité, à ne retenir que la part de son héritage la plus appréciable à leurs yeux.
« S’il y a une dissolution en juillet, les adversaires du RN pourront leur reprocher cette solidarité avec Jean-Marie Le Pen. Mais dans deux ans, le temps aura fait son œuvre, estime Nicolas Lebourg, historien spécialiste du Front national. Reconnaître les excès et les polémiques, c’était aussi s’inscrire dans le camp de ceux qui ont osé. » Pour Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques, « tous ceux qui pensaient que le moment de la mort de Jean-Marie Le Pen allait constituer un moment de rupture connaissent mal la psychologie de cette famille politique, où la repentance n’est pas la norme. »
Les croix celtiques évitées
Le déroulement des deux cérémonies d’hommage au défunt, l’une dans son fief de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), samedi 11 janvier, l’autre à Notre-Dame du Val-de-Grâce (Paris), cinq jours plus tard, était également craint par le parti. Moments de communion de la famille, ils sont aussi éminemment politiques. Dans le village breton, la cérémonie annoncée « dans la plus stricte intimité » a vu des employés de e-Politic, le prestataire de communication du Rassemblement national, filmer la lente marche de la famille Le Pen vers l’église, comme l’a révélé Libération. Un fascicule revisitant sélectivement l’œuvre politique du défunt était distribué. Plus que tolérées, les chaînes d’information en continu ont pu documenter de près l’émotion familiale.
A Paris, toutes les familles de l’extrême droite française étaient attendues, et craintes par Marine Le Pen. Un important dispositif policier aux abords de l’église, notamment, a permis d’éviter croix celtiques, saluts nazis ou folklore néofasciste, mais pas la présence de nombre d’antisémites patentés. En sortant de l’église, Marine Le Pen a serré quelques mains et arboré un léger sourire qu’elle n’avait plus esquissé depuis la mort de son père.
Dans une interview au magazine de Vincent Bolloré JDNews, convenue avant sa disparition, elle fait une confession d’une ambiguïté absolue, au sujet de l’exclusion de son père en 2015, après la réitération de ses propos négationnistes : « Je me poserai toujours la question : “Est-ce que j’aurais pu faire autrement ?” (…) Je ne me pardonnerai jamais cette décision, parce que je sais que cela lui a causé une immense douleur. » Cette décision est pourtant un marqueur de la vie politique de Marine Le Pen, censé acter son intolérance au révisionnisme et à l’antisémitisme de son père.
Est-ce le regret d’une fille ou de la dirigeante politique ? Son entourage défend la première option, mais les nostalgiques du père seront libres d’y voir une réhabilitation. D’autant plus que le parti, où rien ne se fait sans elle, se prête largement à cette entreprise de ripolinage du profil de son cofondateur.
Des unes avantageuses
Cette forme de réhabilitation a été accompagnée par les efforts des médias du groupe Bolloré, honorant la mémoire d’un homme décrit comme visionnaire. La nécrologie du Figaro décrit « un briseur de tabous » et renvoie les qualificatifs de racisme ou d’antisémitisme aux accusations de « détracteurs », tandis que le tribun d’extrême droite a collectionné les unes avantageuses du Figaro Magazine et de Paris Match. Les dirigeants de gauche n’ont pas, pour la plupart, tenté d’exploiter politiquement le décès du Breton et l’Elysée a refusé de qualifier son héritage politique, relevant, selon la présidence, « du jugement de l’Histoire ». Le premier ministre, François Bayrou, a vu en lui « un combattant » simplement lesté de « polémiques ». Quant à Eric Ciotti, éphémère dirigeant du parti gaulliste Les Républicains, il a assisté aux obsèques de celui qui avait inscrit l’antigaullisme dans son ADN politique.
Les scènes de joie sur la place de la République à Paris, rassemblant quelques centaines de personnes, ont été abondamment commentées et décriées. « Une doudoune léopard qui boit du champagne pour fêter la mort de Le Pen, si l’on est cynique, ce sont plutôt de bonnes images pour nous », glisse le député lepéniste Jean-Philippe Tanguy. « J’étais très pessimiste mais le monde politique s’est bien comporté, la couverture était beaucoup plus humaine que prévu, même à gauche », prolonge le président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale.
Historien spécialiste de l’extrême droite, Jean-Yves Camus voit dans la séquence écoulée un aveu, par la classe politique, que « l’argument moral ne fonctionne pas contre le RN. Depuis le 7 janvier, tout le monde a rappelé l’irrésistible ascension du FN entamée par Jean-Marie Le Pen. Mais personne n’a trouvé la clé pour qu’elle s’arrête ».


Le droit de retrait a notamment été considéré comme justifié pour un salarié chargé de conduire un camion de chantier dont les freins étaient défectueux, ou bien, dans une autre affaire, pour un salarié chargé de nettoyer des voitures dans un atelier où la température avoisinait les 3 °C.
Le danger doit toutefois présenter un certain degré de gravité. A titre d’exemple, le salarié qui quitte son bureau sans autorisation et s’installe dans un autre local au motif que les courants d’air dont il se plaint présentent un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ne justifie pas son droit de retrait.
CA Douai 20 avril 2012 N° 11/01756 (salarié chargé de nettoyer des voitures dans un atelier dont la température tournait autour de 3 °C : retrait justifié).
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-droit-retrait.html
Entre 7°C et 12°C pour un emploi pas physique/où on est statique (contrairement au nettoyage de voiture), ça ne semble pas délirant du tout ? Si c’était le courant d’air, là j’aurais été d’accord :)
De plus, le premier paragraphe de cette page mentionne les locaux non chauffé… et les risques d’agression ! Evidemment, tout dépend du contexte et du cas particulier. Je n’ai aucune idée de ce qu’aurait été le jugement dans ce cas, mais ça n’a pas l’air d’être un abus évident. Je ne vois pas non plus pourquoi ça serait prémédité.
Matériel non conforme, locaux non chauffés, absence d’équipements de protection collective ou individuelle, risque d’agression, sont autant de situations susceptibles de justifier le droit de retrait des salariés.
Ce qui est criticable je pense (et mentionné par le vice-président de la région), c’est le fait d’avoir vérifié seulement le matin même si le chauffage marchait.

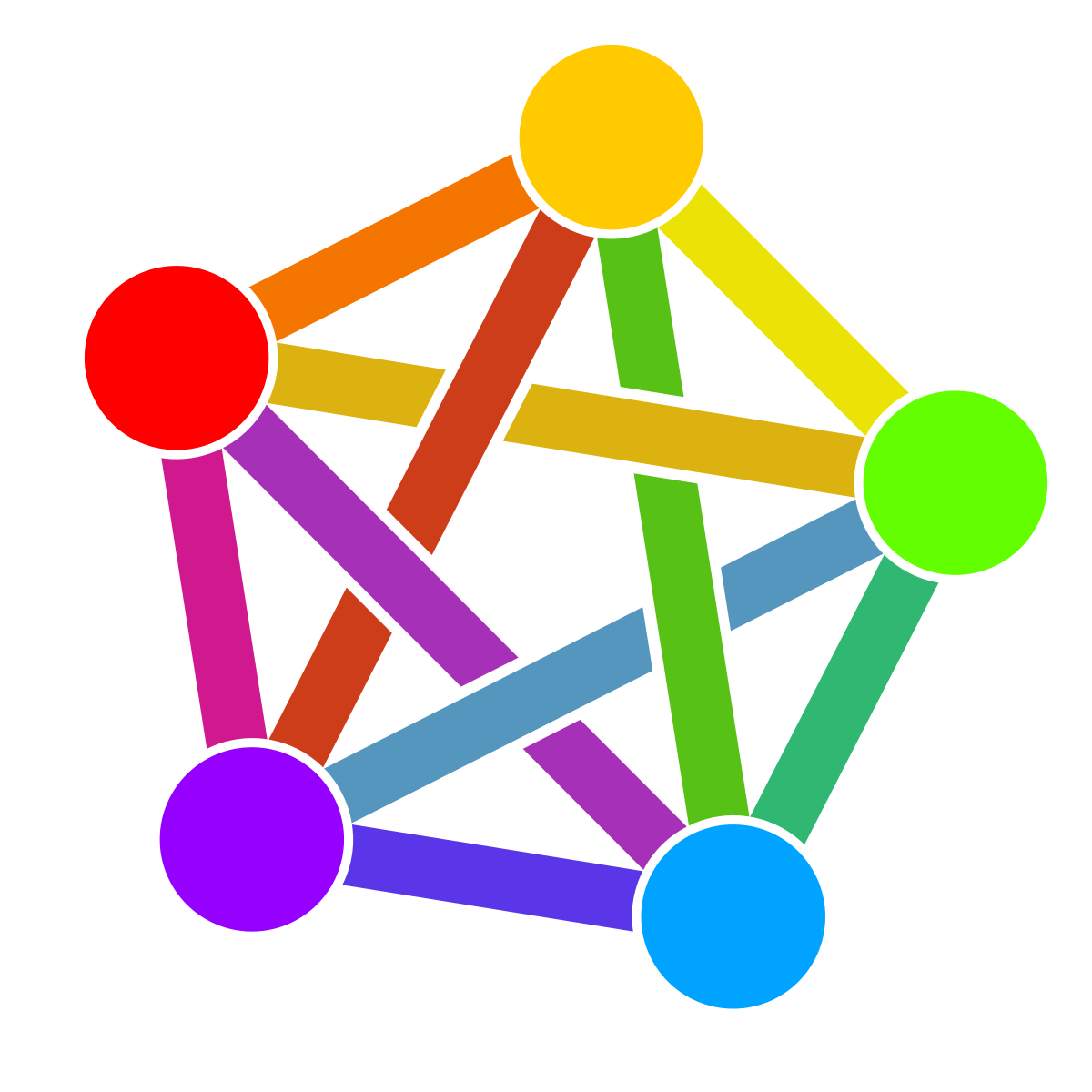
right, this is quite evocative and what I initially had in mind, but the question seems to be more subtle? A village is a single centralized unit, here instances can defederate and users can block traffic. Will threads users invade the fediverse village or just not care about it, even if they have access? Could it give an opportunity for ppl to read content that will ever only be threads (political figures. institutions, etc.) without having a meta account and using a meta app? Will the bots that apparently plague threads rn will plague the fediverse? Why don’t they now? If some instances defederate and others not, could I have one account where I talk to the tourists, and another account in a defederated instance where I’m back in my calm village?
I agree with the imagery and moral aspects, but I feel like understanding the practical implications which are not obvious to me is important to gather momentum to kick them out - I felt like people disagree on subjects that they probably shouldn’t if they both had the same understanding of the situation (which includes me).

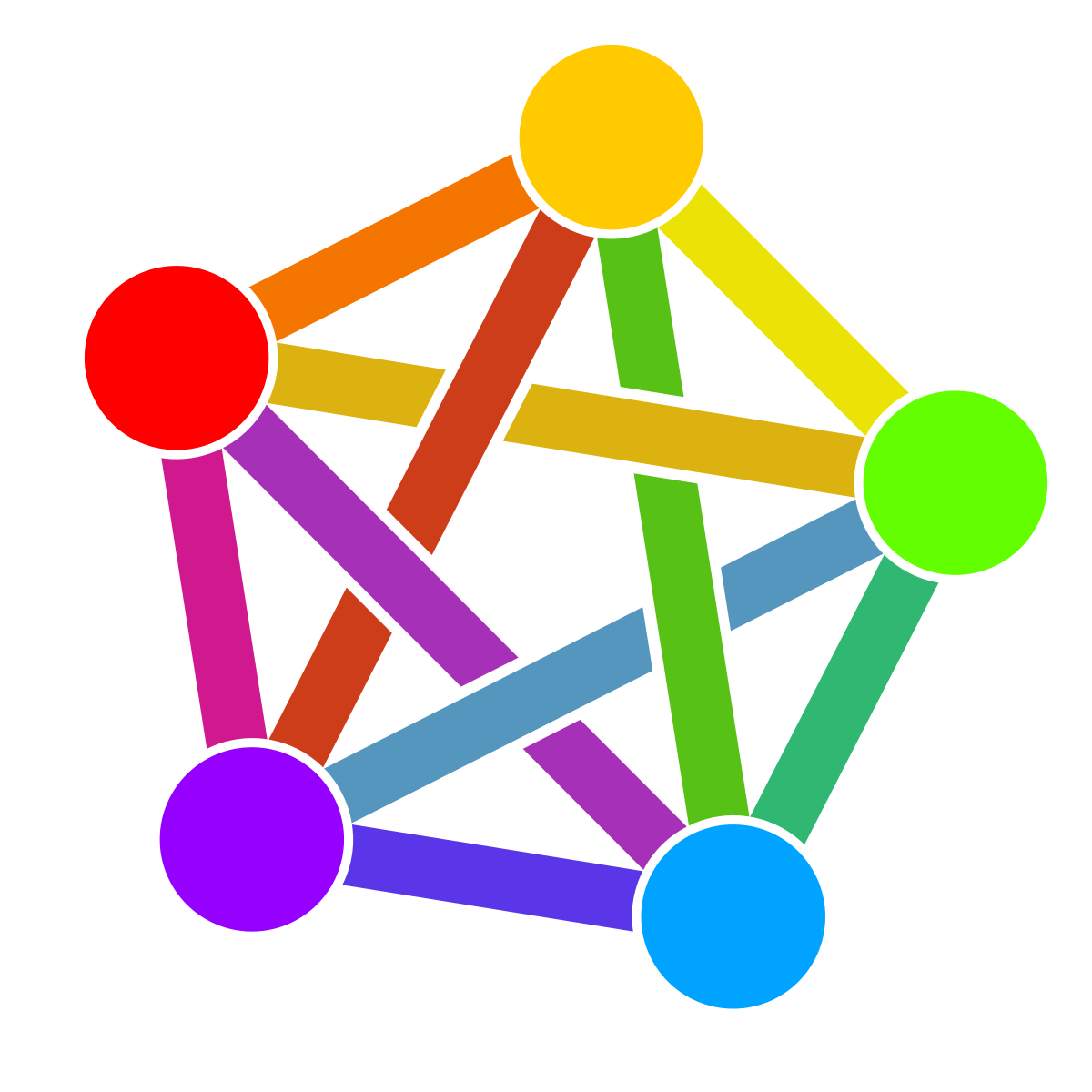
is there a writeup somewhere that ideally goes into enough detail to clearly understand how instances/federation work and what would really happen ? I hate Meta but I realize I have no clue what threads coming means and implies, decentralized systems are very unintuitive when you’re used to conventional social media.


Au long terme, je crois qu’il y a aussi la peur de voir meta qui “embrace and extinguish” le fediverse/activitypub (article de ploum partagé 100 fois aujourd’hui sûrement) Je ne sais pas à quelle point c’est une inquiétude légitime, mais c’est vrai qu’en regardant ce qu’il s’est passé lorsqu’un géant “s’introduit” dans un système décentralisé et a autant de poids (en utilisateurs, mais aussi en moyens humains et monétaires) sur une norme (xmpp, activitypub, docx,…), je ne vois pas comment ca pourrait être mieux qu’un système où les deux cohabitent côte à côte.
Mais une différence par rapport à ces exemples qui a déjà été évoquée, c’est comment meta va s’en sortir pour modérer du contenu qui n’est pas “le sien”.
Johanna Barasz : « La crise de recrutement des enseignants est désormais structurelle, et on n’entrevoit pas de perspective de résolution mécanique »
Alors que les concours sont une fois encore déficitaires, Johanna Barasz, autrice d’une enquête sur l’attractivité du métier d’enseignant pour le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, décrypte les ressorts d’une crise du recrutement, mais aussi de la fidélisation des enseignants.
Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan a publié, le 18 juin, une étude intitulée « Enseigner : une vocation à reconstruire, un équilibre à restaurer ». L’autrice de l’analyse, Johanna Barasz, expose les principaux enseignements de cette enquête quantitative et qualitative sur les singularités et les ressorts d’une crise du recrutement plus inquiétante que toutes celles que l’éducation nationale a connues.
L’éducation nationale a déjà connu des difficultés de recrutement par le passé. Qu’est-ce qui distingue la crise actuelle des précédentes ?
L’éducation nationale a en effet déjà été confrontée à des épisodes de crise, qui étaient principalement dus à deux phénomènes. D’une part, la croissance de la démographie scolaire et, d’autre part, l’élévation continue du niveau de recrutement des enseignants, qui a régulièrement provoqué des problèmes assez massifs de recrutement.
La crise actuelle est différente. La baisse des candidatures s’inscrit dans un temps long, elle est généralisée – avec d’importantes nuances, certes – à tous les concours, et elle est déconnectée des deux facteurs que je viens d’évoquer. Elle est également déconnectée de la situation économique, et ne s’explique pas non plus par les évolutions du nombre de postes offerts au concours, auquel les effectifs de candidats se sont longtemps ajustés.
On peut désormais sans conteste parler d’une crise structurelle, et on n’entrevoit pas de perspective de résolution mécanique puisque le vieillissement de la population enseignante va entraîner des départs à la retraite massifs dans les prochaines années, alors même que les viviers universitaires se tarissent dans plusieurs filières menant à l’enseignement.
L’éducation nationale connaît également une hausse des démissions. A quel point ce phénomène est-il inquiétant ?
La « fidélisation » des enseignants est un problème relativement nouveau pour l’éducation nationale. Rapportées aux effectifs totaux d’enseignants, les démissions sont marginales, mais rapportées au nombre d’enseignants qui quittent chaque année l’éducation nationale, elles dessinent un phénomène beaucoup plus préoccupant : elles représentent 15 % des départs annuels, contre à peine 2 % il y a dix ans. Et elles ne sont plus l’apanage, comme cela a longtemps été le cas, des stagiaires : l’augmentation des démissions est désormais portée par des enseignants de plus de cinq ans d’ancienneté, qui constituent 60 % des démissionnaires.
Vous parlez d’un effet « boule de neige » de la perte d’attractivité…
En dégradant les conditions de travail de ceux qui restent, la pénurie engendre la pénurie. Par exemple, les difficultés de recrutement rigidifient le mouvement des enseignants et se traduisent par des difficultés de plus en plus importantes à obtenir une mutation.
C’est une dégradation manifeste de la qualité de leur emploi, vécue par les professeurs mais également perçue par les étudiants que nous avons interrogés, qui craignent d’être maintenus dans les territoires en tension. Cela affecte directement l’image du métier et donc la capacité à recruter.
Quels sont les ressorts de cette perte d’attractivité, alors même que les enseignants affirment massivement qu’ils aiment leur métier ?
Les enseignants adorent leur métier, 92 % d’entre eux disent ne pas regretter leur choix. Mais ce qu’ils veulent avant tout, c’est avoir les moyens de bien le faire. Or, ils ont de moins en moins l’impression de pouvoir remplir leur mission auprès des élèves en raison de la dégradation perçue des conditions de travail et d’un manque de moyens.
Notre enquête montre également à quel point les relations dégradées avec leur hiérarchie administrative, le manque de reconnaissance ou encore la succession des réformes, qui ressort très nettement dans notre enquête comme un motif de découragement, alimentent leur malaise. Tout cela nourrit un profond sentiment de perte de sens qui pèse lourdement sur la profession.
Bien que les enseignants aient une meilleure image qu’ils ne le pensent, ce sentiment de détérioration des conditions d’exercice est bien perçu à l’extérieur. On voit le métier comme « sacrificiel », qu’on estime, mais qu’on ne veut pas forcément exercer.
L’enjeu des rémunérations est aussi souvent évoqué par les enseignants. Les hausses de salaire décidées depuis 2022 n’ont-elles eu aucun effet ?
Le taux d’insatisfaction salariale reste singulièrement élevé. La rémunération s’apprécie au regard de l’engagement demandé, du niveau de qualification et de la comparaison avec d’autres métiers que l’on aurait pu exercer.
Or, quand les enseignants se comparent à leurs homologues d’autres pays ou aux autres fonctionnaires de catégorie A, ce qu’ils sont eux-mêmes, ils sont perdants, et même de plus en plus perdants. Le métier n’a jamais été bien payé, mais ce sacrifice salarial a longtemps été compensé par une série d’avantages. Cet équilibre-là paraît rompu.
Les mesures de revalorisation sont connues par les enseignants, mais elles n’ont pas changé l’image d’un métier mal payé. Dans notre enquête, quand on demande aux gens, notamment aux étudiants, combien sont payés les enseignants en début de carrière, ils répondent « autour du smic », « 1 500-1 600 euros ». Le fait que le salaire d’entrée des titulaires soit désormais à 2 100 euros n’est pas intégré.
Le gouvernement a engagé une réforme de la formation initiale et en fait un levier majeur pour améliorer l’attractivité. Cela vous paraît-il suffisant au regard de l’enjeu ?
Le renforcement de la formation initiale est une bonne chose, la question de la place du concours dans le cursus des étudiants est une dimension importante, mais il faut réfléchir plus largement à reconstituer les viviers universitaires : dans certaines filières, le nombre d’étudiants est réduit bien avant la licence 3. Et il nous semble important d’avoir une stratégie globale et d’agir simultanément sur l’ensemble des leviers : reconnaissance, rémunération, mutations, conditions de travail, image du métier…
Cette crise ne se résorbera pas d’elle-même. Il faut restaurer l’équilibre entre le sens du métier, la reconnaissance de celui-ci, et les conditions d’exercice, si on veut avoir non seulement suffisamment d’enseignants quantitativement, mais aussi suffisamment d’enseignants bien formés qui se projettent durablement dans ce métier.